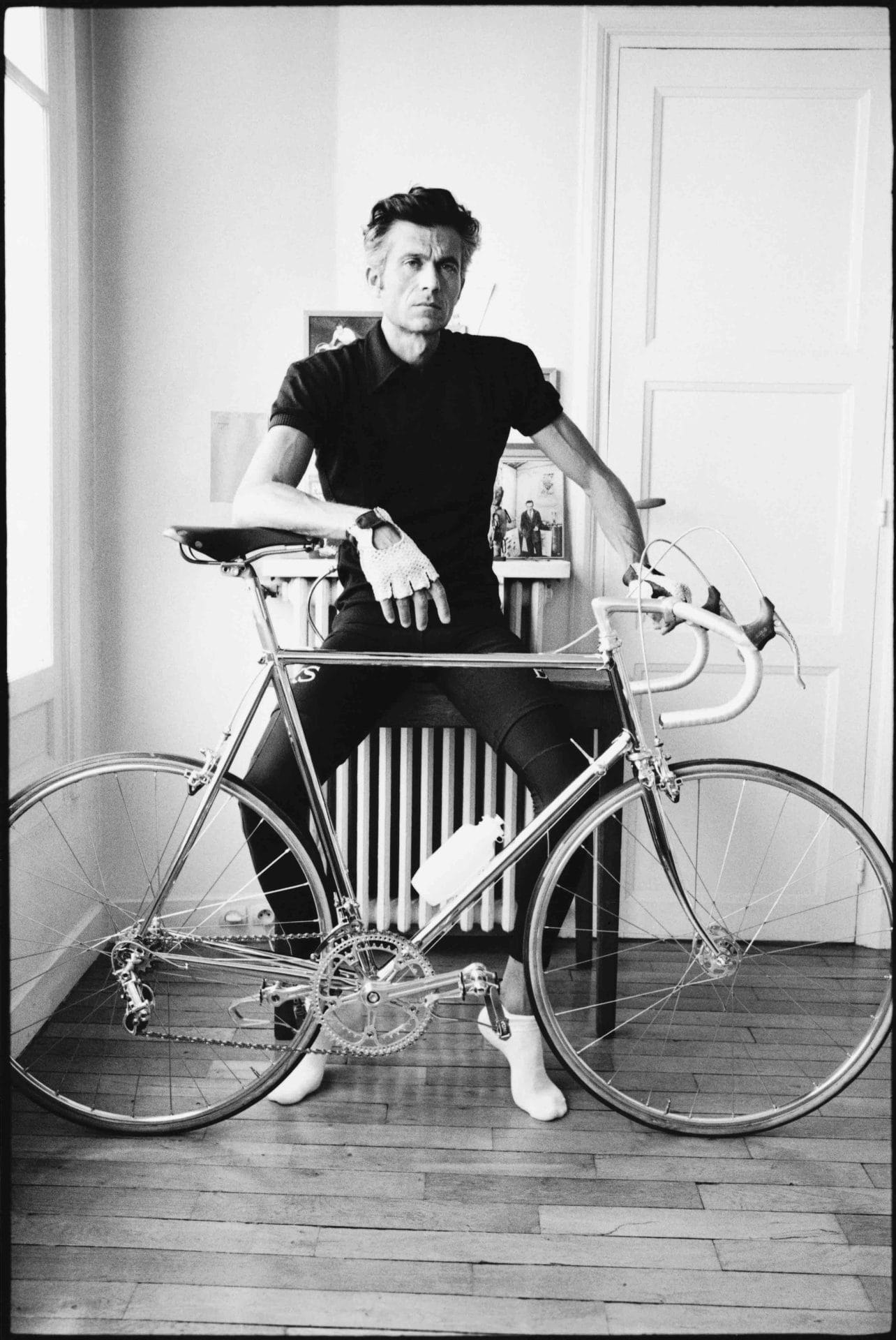Morose magique
Il existe en Grande-Bretagne une tendance à capturer ce que la majorité de l’humanité qualifierait de « laid » ou de « sinistre », et que les Anglais appellent « bleak ». Pourquoi ? Éléments de réponse avec trois photographes qui magnifient le morose.

Qu’est-ce que la beauté ? À cette question hautement philosophique, rares sont ceux qui invoqueraient instantanément des fils barbelés, des zones pavillonnaires mornes, des sandwiches secs et sans vie ou des lambeaux de sachets plastique pris dans les griffes d’arbres décharnés. Au Royaume-Uni pourtant, les photographes s’échinant à capturer la beauté cachée de cette matière visuelle mal aimée sont nombreux. Peut-être plus qu’ailleurs, il existe au pays de Joy Division une tendance à capturer ce que la majorité de l’humanité qualifierait de « laid », « glauque » ou « sinistre ». En anglais, on utilise le mot « bleak ». Pourquoi ? Éléments de réponse avec trois photographes qui magnifient le morose.
Robin Friend, photographe britannico-australien résidant à Lewes, une bourgade du Sussex, auteur de Bastard Countryside (Loose Joints, 2018).
Avant de m’installer ici, j’ai grandi en Australie. Quand j’ai commencé à prendre des photos sérieusement, je cherchais à trouver en Angleterre des éléments qui me rappelaient les paysages australiens. Je cherchais des couleurs rouillées, argentées. Et quand tu commences à regarder ce genre de paysages, tes yeux tombent sur les ruines de l’industrie. La Révolution Industrielle est née ici. Forcément, cela a eu un impact sur l’esthétique des choses et sur les photos que l’on prend.
Mais ce genre de photographies, à mon sens, remonte à celles prises dans les années 1960 par Bernd et Hilla Becher, de ce qu’on a appelé la Düsseldorf School of Photography. Ils ont fait des typographies de châteaux d’eau, en grands formats, photographiés de façon très méticuleuse, quand le ciel était couvert. Ils montaient des échafaudages pour prendre les photos d’une certaine hauteur. Ce sont des photos cliniques et austères. Puis, à partir de 1976, ils ont enseigné leur art à certains de mes photographes préférés, comme Andreas Gursky, Thomas Ruff, Thomas Struth et Axel Hutte. Ce que j’ai retenu en les étudiant, c’est cette lumière plate, monocorde. Dans leurs photos, il y a peu de contrastes directs, pas d’ombres. C’est une façon de photographier qui paraît un peu hors du temps. C’est Jem Southam, un photographe de paysages, qui m’a parlé d’eux. Il shootait de façon similaire, toujours sous une lumière nuageuse. Le côté « bleak« , sinistre, dans la photographie, c’est aussi des conditions météorologiques. Si je vivais quelque part où il fait toujours beau, j’aurais honnêtement du mal à être photographe. Je suis plus productif en automne, en hiver, à la rigueur au printemps. Quand le temps est sinistre, c’est idéal pour mon travail. Alors le Royaume-Uni, avec ses ciels blancs ou sombres, est parfait pour moi. Le ciel est couvert 80% du temps !

8 Mill Creek, Tide Mills, 2006 ©Robin Friend
Longtemps, je ne sortais même pas mon appareil photo s’il y avait du soleil. Notamment quand je travaillais sur mon livre Bastard Countryside. C’est l’auteur Robert Macfarlane qui m’a donné le titre. Il m’a parlé de cette phrase de Victor Hugo dans Les Misérables : « Cette espèce de campagne un peu bâtarde, assez laide, mais bizarre et composée de deux natures, qui entoure certaines grandes villes. » Il décrit Paris comme une espèce de serpent qui se déverse dans la campagne et crée des zones hybrides, qui ne sont ni la ville ni la campagne, mais un peu des deux. Et c’est exactement ce qui m’intéresse : les zones hybrides. C’est nous et la nature entrelacés. Je m’intéresse à la dégradation, au déclin de l’industrie, particulièrement à notre époque, quand on sait qu’avec le changement climatique, la situation du monde est précaire. On n’est pas loin d’être une zone sinistrée. Et tout ceci découle de l’industrialisation.
Dans le livre, il y a une photo de trois immeubles : un bleu uniforme empaquette les échafaudages qui grimpent le long de trois tours, dans une réserve naturelle du nord de Londres. La vue des gens qui habitent ces appartements est obscurcie. Ils sont coupés de la nature. C’est une métaphore du moment auquel notre espèce se trouve. Notre relation avec la nature est confuse. On en fait partie, mais on s’en rend moins compte. Je vis dans une petite ville entourée de campagne, mais dans les grandes villes, on peut passer plusieurs jours d’affilée sur du béton, sans que nos pieds ne marchent sur de l’herbe.
Dans Bastard Countryside, il y aussi une photo d’une bouée gisant dans l’eau. Avec cette image, tu peux te raconter une histoire. Il y a une corde, un trou. Le gamin en moi se demande ce qui se trouve à l’intérieur. Est-ce un portail vers un autre monde ? Sur le moment, tu sens quelque chose. Quand j’ai photographié un cachalot échoué sur une plage du Norfolk, ma compagne m’a dit que personne ne voudrait jamais acheter une telle photo. Ce n’était pas le but ultime, mais j’en ai vendu quelques-unes… Les gens peuvent ressentir du dégoût en la voyant, mais cette image a quand même une forme de beauté. Ce grand cachalot a perdu la vie. C’est d’une grande tristesse. Ces deux femmes hésitaient à l’approcher. Finalement, une d’elle a mis sa main sur son nez. C’est un moment intime. Il y avait plusieurs cachalots échoués le long de la côte, sur lesquels des chiens grimpaient, des gens faisaient des graffitis… Certains coupaient des morceaux. J’ai saisi un moment plus calme. Il y a cette épave de bateau derrière lui. Et le rouge qui saigne dans le paysage. Ça me fait penser à une autre épave de bateau, que je retourne voir régulièrement depuis vingt ans, tout au bout des Cornouailles. Elle est toute rouillée et j’ai toujours l’impression qu’elle saigne, elle aussi. La rouille progresse sur la façade de la falaise. Ça change à chaque fois que j’y retourne. Je suis une sorte de funambule, qui avance sur une corde avec le beau d’un côté et le laid de l’autre. Dans Bastard Countryside, il y a beaucoup de choses laides. La matière, c’est beaucoup de choses mortes, de détritus, d’ordures. De choses jetées, négligées, oubliées. Mais je trouve qu’il peut y avoir une vraie beauté dans ces choses-là. Tu peux les élever. Une benne à ordures rouillée peut être belle. C’est une question d’alchimie. On peut faire en sorte que ces choses apparaissent être d’autres choses. Il y a un côté sculptural. La beauté est subjective, mais c’est quelque chose qui te donne des sentiments. Un moment peut être beau. Tu le ressens, tu ne le vois pas. C’est dur à définir et c’est en partie pour ça que c’est merveilleux.
[Cet article est à retrouver en intégralité dans Sphères N°18 : les photographes]