
Mode et écologie, peut mieux vert
Si les considérations écologiques sont en vogue chez certains jeunes créateurs et étudiants, elles pèsent encore peu face aux géants de la fast-fashion, leurs prix cassés et leurs stratégies marketing. De la production des matières premières jusqu’à la fin de vie, la mode reste une industrie dévastatrice pour le climat, l’environnement et les travailleurs.

Le soleil et sa trentaine de degrés tapent sur la tôle d’un entrepôt massif, longé par les rails du RER E. Sur le béton du parking, une femme transporte deux rouleaux beige translucides et une pile de tissus vers sa voiture. À l’intérieur, on trouve pêle-mêle : de gros socles de présentation, des rouleaux de tissu de toutes les couleurs ou encore une pile de coton gratté noir qui sert à cloisonner les catwalks des défilés. « On est dans une période de grosse activité, explique Lucie Bonafonte, chargée de la communication à la Réserve des arts. On a travaillé sur neuf défilés de la Fashion week, il aura fallu quarante-et-un camions pour tout apporter ici. Le dernier est arrivé hier. »
La semaine de la mode rythme la vie de l’association. Chaque année depuis 2008, la Réserve des arts collecte la scénographie d’une partie des défilés. Le reste de l’année, elle récupère des tonnes de matériaux auprès de musées, magasins, théâtres ou ateliers de production. Plutôt que de les envoyer à la benne, elle les standardise, les sécurise, parfois les démonte aux frais des structures qui veulent s’en débarrasser, puis elle les propose à la vente aux treize mille adhérents de la structure, pour la plupart des étudiants en mode, design ou architecture. Sur une année, les matériaux de la Paris Fashion Week représentent plus de la moitié de ce que la réserve collecte chaque année, 722 tonnes au total en 2022. Impossible de connaître le nom des marques partenaires, qui font signer des accords de confidentialité à la Réserve. Charlène Dronne, directrice de l’association, concède du bout des lèvres qu’on trouve parmi elles « des groupes et des maisons de la place parisienne ».
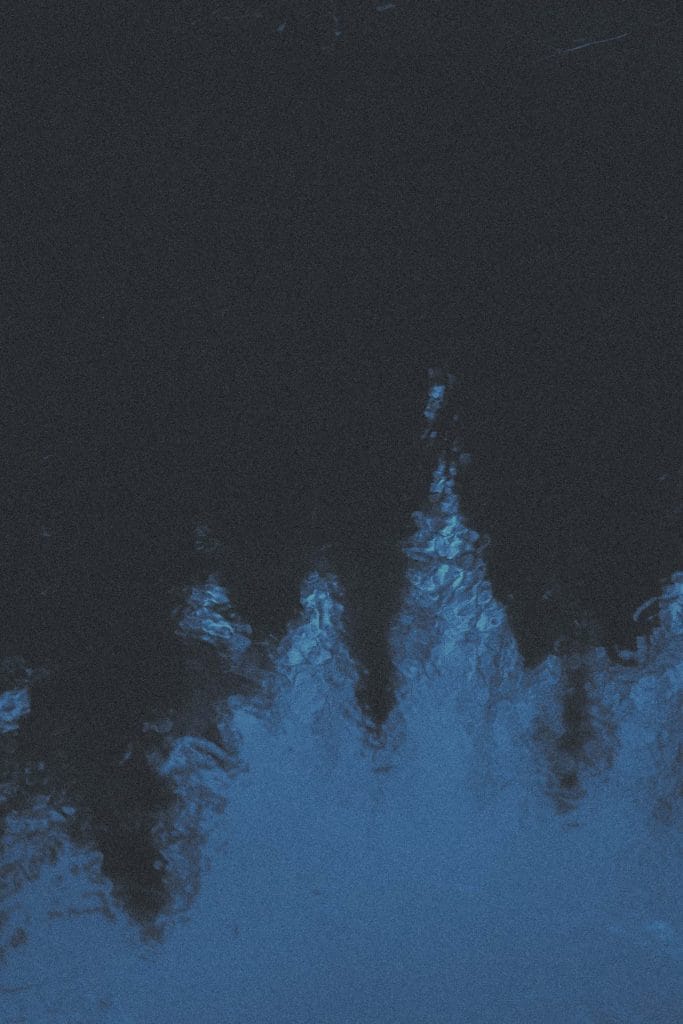
Tout va mal
Plusieurs fois par an, les Big Four, soit les Fashion weeks de New York, Londres, Milan et Paris, donnent lieu à des centaines de défilés qui durent généralement de quinze à vingt minutes. Pour Catherine Dauriac, présidente de l’ONG Fashion Revolution France et journaliste mode, les mentalités évoluent petit à petit, notamment depuis le Covid : « Sur les deux dernières Fashion weeks à Paris, il y avait beaucoup moins de décors chez Chanel ou Dior, par exemple. » Néanmoins, « toute la fashion sphère se balade entre les quatre pays avec des avions, reprend-elle. Ça fait trente-cinq ans que je travaille dans la mode, moi aussi je l’ai fait. Mais aujourd’hui, on ne peut plus ! »
En réalité, et en comparaison avec le reste de l’industrie, les Fashion weeks ont un impact minime sur l’écologie et le climat. La majorité des dégâts est faite avant que les collections ne soient révélées sous les crépitements des flashs. Toutes les étapes de la vie d’un vêtement posent problème. La production de la matière première d’abord, sa transformation ensuite, son transport entre ces étapes et puis dans le pays d’exportation, son lavage qui envoie des microplastiques dans les océans, et enfin sa fin de vie, avec moins de 1% du tissu recyclé en de nouveaux habits. Au total, chaque année, la production des vêtements et des chaussures dans le monde est responsable de quatre milliards de tonnes de gaz à effet de serre, soit davantage que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Bref, tout va mal. Si mal que lorsqu’on a appelé Catherine Dauriac pour savoir si la mode pouvait être écologique, elle nous a répondu : « La réponse est non, au revoir », avant d’exploser de rire.
Un carré brun et un tee-shirt jaune-orange qui laisse voir le bas du ventre, Juan Corrales, vingt-huit ans, a les mains plongées dans les bobines de fils. Styliste freelance pour plusieurs maisons de couture, il est venu ici car les matériaux sont de bonne qualité, les prix très intéressants, et parce qu’il considère que la mode circulaire et l’intégration de considérations écologiques dans sa pratique sont nécessaires. « Il faudrait qu’on arrête de faire de la mode dans le seul but de produire et qu’on se focalise sur le fait de produire mieux, pose Juan. Il faudra un peu de temps pour que les mentalités changent de façon durable. Parce qu’il faut que les maisons sortent des chaînes de production qu’elles ont eues pendant des années. »

Entre des boutons et des rouleaux de fourrures, trois bacs en plastique bleu sont remplis de petites étiquettes qui affichent : « made in India », « made in Romania », « made in Turkey », « made in Sri Lanka ». Depuis les années 1990, la courbe des importations de vêtements et chaussures en France a grimpé de façon exponentielle. Celle des effectifs de l’industrie textile en France a suivi la dynamique inverse. Ces délocalisations sont le cœur du problème. Elles permettent aux marques de produire à moindre coût, donc de vendre des vêtements à bas prix. Pour Julia Faure, fondatrice du collectif En mode climat, « la production a été délocalisée dans des pays qui sont moins-disant socialement et écologiquement. Si ce n’est pas cher, ça veut dire que ce sont la nature et les gens qui paient. »
Produire moins pour payer plus
Le salaire et les conditions de travail des ouvriers sont difficilement dissociables des dommages environnementaux. Au Bangladesh, qui produit une grande partie du textile mondial, le salaire minimum dans le secteur des vêtements et du textile est de quatre-vingts euros par mois. Soit un quart de ce que les ONG appellent le salaire vital, celui qu’il faudrait pour pouvoir vivre dignement. Beaucoup gardent en tête le drame du Rana Plaza où au moins 1 100 ouvriers du textile avaient perdu la vie en 2013 après l’effondrement d’un immeuble à Dacca, capitale du Bangladesh. Conseil conso de Julia Faure : avant d’acheter un vêtement, « regarder si c’est produit dans un endroit où on enverrait son enfant faire un stage à l’usine. » Autre conseil, à plus long terme : « Relocaliser en France. »
Des prix bas offrent aux consommateurs la possibilité d’acheter presque sans limites. « Le problème dans l’industrie de la mode n’est pas l’impact individuel par vêtement mais les volumes : on produit beaucoup trop », affirme Julia Faure. Entre 2000 et 2014, la production de vêtements a doublé selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). C’est la raison pour laquelle Julia Faure, qui est également fondatrice d’une marque de prêt-à-porter, ne fait pas de publicité, incite à acheter le moins possible dans sa boutique et ralentit le rythme de ses collections.
L’inconvénient de cette ligne de conduite, c’est l’impact sur le prix du vêtement. « Quand nous relocalisons, nos vêtements deviennent bien plus chers que ceux fabriqués à bas coût à l’autre bout du monde », alertait le collectif de la créatrice dans une tribune publiée dans Le Monde en juillet 2021, appelant à davantage de régulation des marques textiles. Chez Loom, la marque de Julia Faure, comptez au moins vingt-cinq euros pour un tee-shirt et autour de cent euros pour un jean. Les marques éthiques et responsables s’en retrouvent nécessairement défavorisées face à la concurrence, même si leurs vêtements, souvent de meilleure qualité, peuvent être gardés plus longtemps. Et non pas, comme le souligne Julia Faure, portés quelques jours voire pas portés du tout avant d’être « envoyés dans les pays d’Afrique comme les déchets de la fast fashion.»

Des montagnes de déchets
Les cheveux au vent, une chemise bleue sur le dos, Matteo Ward fait quelques pas et plonge la main dans le mur de vêtements et de chaussures qui se dresse devant lui. Il en sort un tee-shirt pour enfant, une basket Adidas, une tong. Puis il grimpe au sommet du tas de déchets haut d’une vingtaine de mètres, depuis lequel on peut apercevoir le bidonville d’Old Fadama, à Accra, capitale du Ghana. Derrière lui, une vache passe. Devant, à perte de vue, des vêtements par millions. « La combinaison de la chaleur, de l’odeur et du désespoir des gens » a fait de ce lieu un des plus marquants que Matteo Ward ait visité pour le tournage de JUNK. Dans cette série documentaire, qui sortira bientôt à l’international, le trentenaire italien enquête dans différents pays dans lesquels l’industrie de la mode fait des ravages humains et environnementaux.
S’il a décidé d’aller dans la capitale ghanéenne, c’est parce que quinze millions de vêtements y arrivent chaque semaine, jetés par des consommateurs d’Asie et des pays occidentaux. Un volume bien trop important pour une population de 4,5 millions d’habitants, forcés d’en brûler une partie et de laisser le reste s’accumuler. D’autant plus que la qualité des vêtements qui ne cesse de décliner leur permet de moins en moins de les revendre sur le grand marché de la capitale. « Ce que les photos ne montrent pas, c’est que la morphologie de la ville entière a été modifiée : il y a des kilomètres de falaises faites de déchets textiles, des maisons construites dessus, du bétail qui vit et marche dessus, des enfants qui n’ont jamais vu la couleur du sable », explique Matteo Ward, qui est aussi le créateur d’une marque durable, depuis son bureau à Vicence, en Italie. Par rapport à il y a quinze ans, les vêtements sont jetés en deux fois moins de temps après leur achat.
Nouveau pays, nouvel épisode, nouvelle scène. Cette fois ci, sur l’écran, des feuillages verts à foison, ceux de la dernière forêt intacte de Sumatra, en Indonésie. En fond, par-dessus le pépiement des oiseaux et le bruissement des feuilles, le bruit sourd des scies qui entament l’écorce des arbres. Ceux-ci servent à fabriquer la viscose, matière au rendu soyeux fabriquée à partir de cellulose, une fibre végétale. Alors même qu’elle paraît plus vertueuse que les matières fabriquées à partir de pétrole comme l’acrylique et le polyester, la production de viscose nécessite elle aussi un traitement avec des produits chimiques, et n’est pas sans dommages pour l’environnement. La colère de Matteo Ward est intacte. « Cette forêt tropicale est l’un des endroits les plus riches en biodiversité et les plus précieux de la planète Terre. Et tout d’un coup, elle disparaît, sous vos yeux. Pour quelque chose d’aussi futile que des tee-shirts en viscose. »

La transition, affaire de la nouvelle génération
Les matières sont au centre des préoccupations environnementales. Elles sont aussi au cœur du master « mode et matière », une formation créée par l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, l’Université Paris-Dauphine PSL et les Mines, qui disent vouloir ainsi contribuer à « la construction d’une mode responsable et sociale ». On assiste à un cours, donné fin octobre dans une salle de classe parisienne. « La viscose peut ressembler à de la soie, mais lorsqu’on la brûle, ça sent le papier parce qu’elle est faite à partir de cellulose », explique une professeure à une trentaine d’étudiants, avant d’en faire la démonstration. Une odeur de cramé monte dans l’air. En plus de s’informer sur chaque matière, les étudiants ici présents se renseignent sur leurs transformations. Car l’assouplissement, la teinte ou le délavage sont là encore des étapes de production dommageables pour l’environnement et le climat.
Kozué Sullerot, étudiante de vingt-deux ans en deuxième année de master mode et matière, se spécialise dans la teinture. En plus d’utiliser beaucoup d’eau et de nombreux produits chimiques, le processus de teinture requiert aussi une grosse quantité d’énergie : il faut chauffer l’eau, la faire refroidir, la faire chauffer à nouveau… Kozué est partie au Maroc, pendant deux mois, pour apprendre à colorer les fibres de façon naturelle avec des noix, de la poudre de grenade, de l’indigo… En revanche, il est difficile d’obtenir deux fois la même couleur avec ce procédé, ce qui explique pourquoi la teinture naturelle est boudée par les industriels, au profit de teinture chimiques et toxiques. « Il y a plein d’industries qui balancent les jus de teintures toxiques dans les fleuves et les rivières. En Europe, il y a des lois qui empêchent ces pratiques », explique Kozué. Mais la plupart de nos vêtements ne sont pas teints dans le périmètre de l’Union européenne.
Après une matinée de cours, quelques étudiants se regroupent pour déjeuner. Au-dessus de son tupperware de pâtes, Kozué soupire. Tout ça est quand même un peu démoralisant. Et même si les mentalités changent, les stratégies marketing qui poussent à consommer plus semblent toujours fonctionner sur la jeune génération. Manon Lecussan, vingt-et-un ans, souligne : « C’est une catastrophe, quand on va faire un tour en fripes, il n’y a pratiquement que des vêtements qui viennent de la fast fashion. » En face d’elle, Kozué renchérit : « On est dans une ère de la rapidité. Les réseaux sociaux nous envoient des images constamment, forcément, on a envie de consommer. » À côté d’elles, Mathys Tarbes, vingt-trois ans, fard coloré sur les paupières, acquiesce. Lui, qui monte sa propre marque de mode durable et non genrée et assure s’être « extirpé de la fast fashion », dit que la norme sociale est encore de suivre la tendance. Récemment, des copains lui ont fait remarquer qu’il était habillé exactement comme le jour de leur rencontre, cinq ans plus tôt, lui suggérant de changer de vêtements. « Ça m’a vexé, réagit Mathys. Je suis le seul à trouver ça normal de garder des vêtements pendant longtemps ? »

Les trois trouvent quand même des raisons de se réjouir. D’abord, les écoles sensibilisent de plus en plus leurs étudiants à l’écologie. Aussi, raconte Kozué, « j’avais travaillé dans la mise en place de vitrines pour Hermès et le Bazar de l’Hôtel de ville. Je sais qu’aujourd’hui, ils demandent que les personnes qui s’en occupent aient des formations en biomatériaux. » Et de nouvelles marques plus responsables et plus éthiques sont créées chaque année. Mais la bande de copains le sait, ce sera aux designers de demain d’opérer la transition que leurs aînés n’ont pas été capables d’amorcer.
Seconde main, jeu de vilains ?
Retour à la Réserve des arts. Des lunettes de soleil noires Balenciaga remontées sur le crâne et un sac orange minuscule glissé sous le bras, Pauline Krokeide, étudiante en bijouterie norvégienne de vingt-sept ans, cherche des matériaux pour ses créations. Elle s’habille exclusivement en vêtements de seconde main. Où la surconsommation existe aussi. « Il existe des friperies dans lesquelles il y a d’énormes bacs remplis de tee-shirts, qui sont tellement bon marché que vous pouvez juste en prendre beaucoup et les ramener à la maison pour finir par les jeter à nouveau. Ça parait stupide, mais c’est parfois ce que les gens font. » La France est le premier marché de Vinted, la plateforme de vêtements de seconde main, avec plus de vingt millions d’utilisateurs sur le territoire. Or le bilan carbone du marché des vêtements de seconde main, qui sont parfois livrés dans toute l’Europe, n’est certainement pas neutre.
Il existe pourtant des lois censées limiter l’impact écologique et social de l’industrie de la mode. La France avait été l’un des premiers États à se doter d’une loi sur le devoir de vigilance des entreprises, en 2017. En théorie, elle oblige les firmes de plus de cinq mille salariés en France et plus de dix mille à l’étranger, à prévenir et réparer les dommages environnementaux causés par leurs sous-traitants ou par elles-mêmes. Selon Catherine Dauriac, de Fashion Revolution, ce n’est pas suffisant : « Depuis 2017, il n’y a eu aucune mesure coercitive. La loi est appliquée, les entreprises s’y plient, mais elles n’ont pas d’amendes pécuniaires. » Le texte pourrait être étendu à l’échelle européenne. Les vêtements devraient également afficher un eco-score d’ici 2024, censé informer le consommateur sur leur impact environnemental.

Quand nous avions eu Catherine Dauriac au téléphone, le règlement européen REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) devait être révisé dans l’année à venir. Très attendue par les associations de défense de la santé et de l’environnement, la révision aurait dû durcir le texte et limiter fortement le recours à des substances chimiques dangereuses présentes notamment dans les vêtements, certaines étant potentiellement cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Depuis, Le Monde l’a révélé le 17 octobre 2023, la nouvelle est tombée : la commission européenne a abandonné la révision de ce règlement.
Pour Matteo Ward, l’un des leviers les plus efficaces pour faire bouger l’industrie est celui de la santé des consommateurs, impactée par de nombreuses substances chimiques présentes dans les vêtements synthétiques. Il milite pour une approche chirurgicale : « Si une marque fait des sous-vêtements, ils doivent être en coton. Si elle fabrique des vêtements de ski, elle sera autorisée à utiliser un quota de matières synthétiques. Au moins jusqu’à ce que nous ayons une meilleure alternative biosynthétique… Et ainsi de suite. » Julia Faure, elle, s’entretient avec de nombreux ministres via son collectif afin de leur transmettre ses demandes : relocaliser les industries en France ou en Europe où les énergies sont davantage décarbonées, taxer les importations de textiles en dehors de ce périmètre, ou encore encadrer les incitations à la consommation qui seraient trop fortes. Sans effet pour l’instant. « J’ai récemment rencontré le président Macron qui a fait un discours condamnant la fast fashion, explique-t-elle. Tout le monde est d’accord pour dire qu’elle est destructrice économiquement et écologiquement. Mais personne ne prend les mesures qui permettraient de limiter ses impacts. »
Marion Durand




