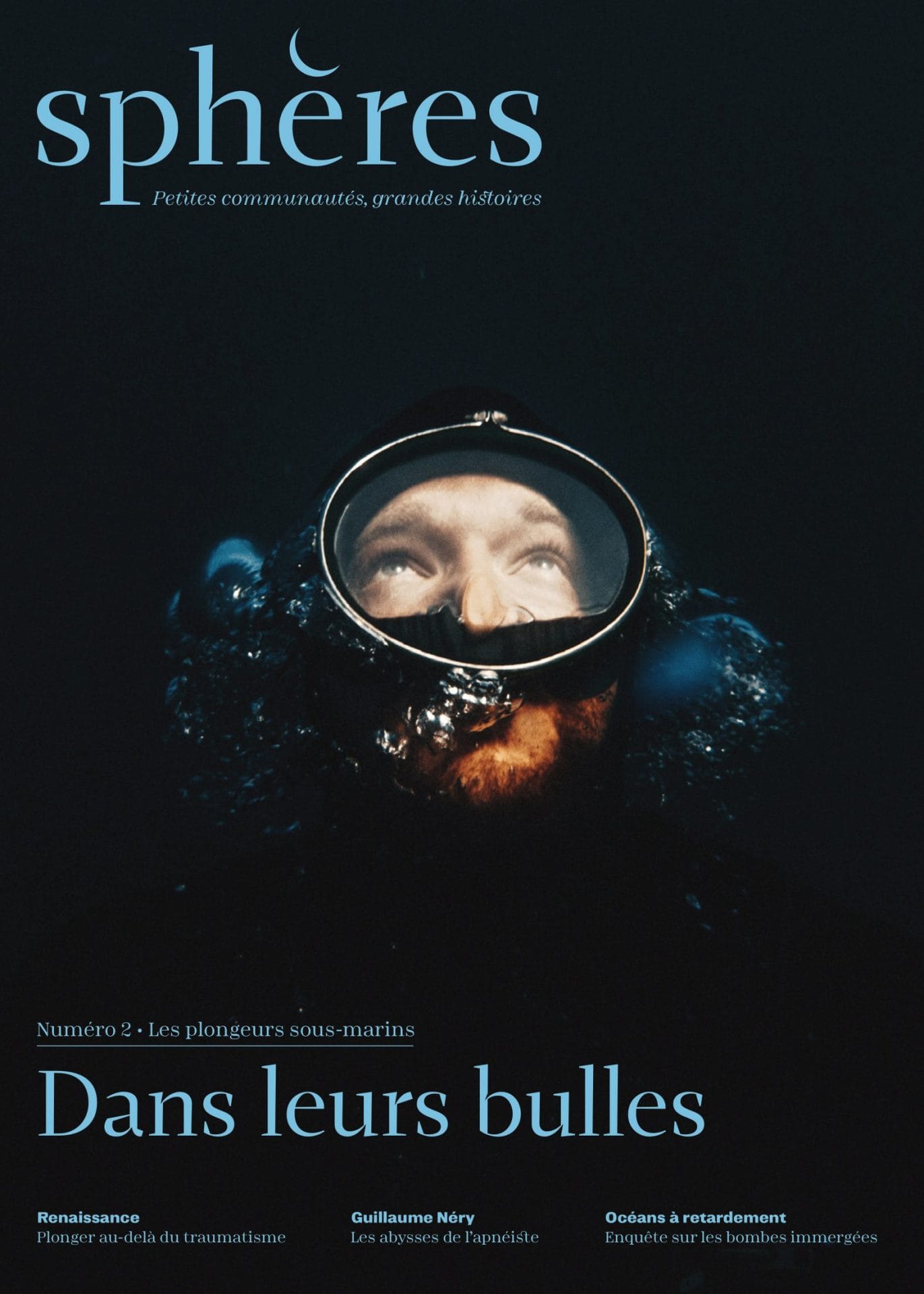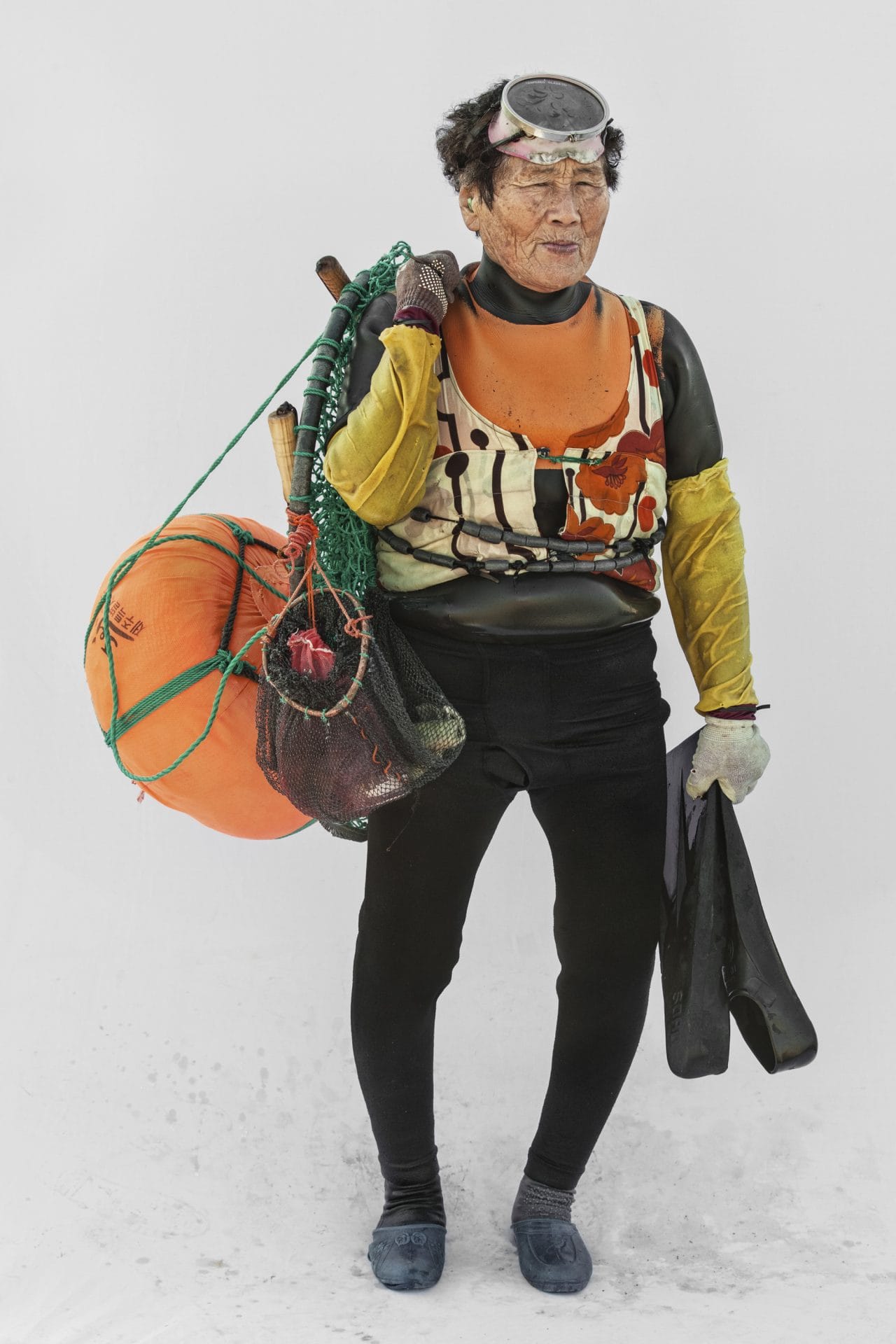Vingt mille bombes sous les mers
Des centaines de milliers de tonnes de munitions explosives ou chimiques gisent au fond des mers, laissant présager un désastre environnemental.

Des centaines de milliers de tonnes de munitions explosives ou chimiques ont été jetées en mer après les deux guerres mondiales. Plus le temps passe, plus leur fuselage se corrode et plus leur contenu se libère, causant des accidents humains et laissant présager un désastre environnemental. Pourtant, les États concernés brillent par leur inaction. Au premier rang desquels la France, où le dossier est classé secret défense.
Des centaines de milliers, avancent certains chercheurs, plus d’un million, enchérissent d’autres, quand les plus alarmistes dépassent le milliard. Difficile de savoir avec exactitude combien de tonnes de munitions explosives se cachent sous nos océans. « Par où voulez-vous commencer ? », lance Terrance Long d’un ton sarcastique, pour débuter la conversation. L’ancien ingénieur militaire vit sur l’île du Cap-Breton, dans l’est du Canada et consacre sa vie aux armes chimiques immergées depuis presque vingt ans. Après une petite heure de dialogue, l’ambiance n’est plus à la plaisanterie. « Je suis juste fatigué, soupire le fondateur de l’International Dialogue on Underwater Munitions (IDUM). Je ne vais pas dire que j’ai gâché dix-huit ans de ma vie, mais j’en viens à me dire que je mourrai avant qu’on ne commence à régler le problème. » Il y a quelques mois, Terrance Long a tenté d’alerter une nouvelle fois les Nations unies sur la contamination globale des mers et océans par les munitions immergées. En vain. « On ne fait rien ! Pourtant, c’est le même problème de pollution que le plastique dans les océans, qui offusque tout le monde ! », s’emporte celui qui ne mange plus de poisson depuis quelques années.
Ces armes immergées datent des deux guerres mondiales. Et si, sur terre, elles sont prises en charge quotidiennement par les services de déminage, celles déversées en mer se retrouvent abandonnées un peu partout dans le monde. Le Middlebury Institute of International Studies de Monterey (Californie) a mis au point une carte interactive de ces dépôts dangereux, représentés par un symbole orange. Un rapide coup d’œil permet de comprendre l’étendue du problème. L’océan Austral semble épargné, les océans Indien et Arctique peu touchés. En revanche, on discerne une très forte concentration d’armes immergées autour du Japon et sur la côte est des États-Unis. L’Europe de l’Ouest, elle, n’est même plus visible, recouverte par les symboles intimidants.

Encore plus inquiétant : un grand nombre de ces armes immergées sont chimiques (environ 10 à 20%). Leur corrosion provoque la libération d’agents toxiques qui contaminent les océans. Selon l’Institut océanographique de Moscou, il suffirait que 16% de leur contenu s’échappe en mer du Nord pour y éradiquer toute forme de vie pendant un siècle. Une prédiction peut-être trop alarmiste et théorique (il faudrait que ces substances se propagent de manière parfaitement homogène en mer), mais qui donne une idée de la menace. Menace que les différents gouvernements et institutions concernés ne semblent pas pressés de résoudre.
Le chemin du Petit Poucet
Pourtant, le problème a plus de cent ans maintenant. À la fin de la Première Guerre mondiale, les Alliés récupèrent d’importants stocks d’armes encombrantes et dangereuses. La méthode la plus rapide et la plus économique pour s’en débarrasser est vite trouvée : tout jeter à l’eau. Cette solution est même jugée écologique ! À l’époque, les études océanographiques ne sont pas très poussées. Alors certains estiment qu’il vaut mieux immerger ces armes plutôt que de les brûler sur terre et ainsi empoisonner l’air alentour. Des navires remplis de munitions quittent donc les ports européens pour tout balancer par-dessus bord à quelques kilomètres des côtes, lorsque la profondeur est suffisante. Les eaux les plus touchées sont la mer du Nord et la mer Baltique. « Mais on a fait ça un peu n’importe comment, explique Dominique Anelli, expert en désarmement et décontamination et ancien membre de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). Les équipages, pressés, commençaient souvent à larguer avant d’être arrivés à la zone indiquée. En suivant les armes jetées dans l’eau, on peut ainsi retracer l’itinéraire des bateaux jusqu’aux fosses. » Ce chemin du Petit Poucet revisité conduit parfois à la découverte de navires entiers, directement coulés pour gagner encore plus de temps. Des déversements ont eu lieu au large de Dunkerque, Gravelines ou Boulogne-sur-Mer. Mais les gouvernements français ont refusé de dire avec précision combien de zones étaient concernées sur notre territoire.

Autre manière de se débarrasser des armes encombrantes : le pétardement en mer. La France l’a pratiqué pendant trente ans. « Cela se faisait en baie de Somme, resitue Dominique Anelli. On mélangeait des armes chimiques avec des armes conventionnelles, on les enfouissait sous le sable à marée basse et on faisait péter le tout. À titre de comparaison, à la même époque, les Belges commençaient déjà à construire un centre pour détruire les armes chimiques. » L’expert reconnaît que la méthode est un peu « olé olé ». D’autant que selon un rapport de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR), « l’explosion de munitions peut présenter un plus grand risque pour l’environnement, aussi bien à cause du dégagement de substances dangereuses que des impacts du bruit. La pression exercée par le bruit important que produisent les explosions spontanées ou contrôlées de munitions peut blesser ou tuer certains mammifères marins et poissons. »
La France ne mettra fin à cette solution qu’en 1993, après avoir signé le traité d’interdiction des armes chimiques, qui l’oblige à les détruire en suivant un protocole particulier. Autrement, cette méthode aurait sans doute fait ses preuves encore quelques années. Il n’y a qu’à écouter la réponse de Michel Sappin, directeur de la Défense et de la Sécurité civiles, interrogé en 2001 par Jacques Larché, le président de la commission des lois du Sénat : « À part quelques poissons, qui aurait pu se plaindre ? Le pétardement en mer n’a jamais posé problème. »
Cabillaud à l’arsenic
Encore aujourd’hui, la loi ne protège pas le milieu marin des vieilles bombes. Selon l’article L218-58 du Code de l’environnement, « l’immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l’Homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l’État en mer ». C’est donc la vie aquatique qui trinque : plus l’enveloppe des bombes chimiques se dégrade, plus elles libèrent leurs agents toxiques dans les océans. Sans grande surprise, la faune et la flore sont touchées. « Un poisson en contact avec ces zones de munitions sera plus vulnérable aux bactéries et aux maladies », explique Jacek Beldowski, chercheur polonais qui participe au projet CHEMSEA (Chemical munitions search and assessment).

Le pire de ces produits toxiques reste l’arsenic car il ne se dégrade jamais complètement. La commission d’Helsinki (HELCOM), qui vise à préserver le milieu marin de la mer Baltique, a publié à ce sujet un rapport édifiant. Il démontre que des cabillauds autour des zones contaminées présentent des lésions dues à l’empoisonnement par les armes chimiques et que de l’arsenic s’accumule dans leur organisme. « Actuellement, on estime qu’environ 20% des poissons de ces zones en mer Baltique ont des traces d’arsenic dans leur organisme, mais à une dose trop faible pour être dangereuse pour l’homme, reprend le spécialiste polonais. On peut donc les manger sereinement. Mais à l’avenir ? Si les munitions libèrent plus de produits, les doses s’accumuleront et on aura des poissons soit non comestibles, soit morts. »
Dernier produit dont on ne se méfie pas et qui peut être très dangereux : le trinitrotoluène, plus connu sous l’acronyme TNT. À plus long terme que les autres produits toxiques, l’explosif provoque des risques CMR (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques) sur les organismes vivants. L’étude de la commission d’Helsinki estime que le TNT attaque le système immunitaire des poissons et empêche certains cabillauds de se reproduire. Tout aussi dangereux que les autres agents toxiques donc, mais bien plus présent puisque l’on en trouve dans toutes les munitions, aussi bien chimiques que conventionnelles. Et si le TNT n’est pas éternel comme l’arsenic, il tient tout de même 5000 ans avant de disparaître.
Ces munitions sont aussi un danger pour les pêcheurs. S’ils connaissent mieux aujourd’hui les précautions à prendre et les zones à risque, des accidents surviennent toujours. Au début du XXIe siècle, les autorités danoises avaient enregistré plus de 400 cas de pêcheurs ayant remonté dans leurs filets du matériel toxique, entraînant de graves blessures et même la mort. « En 1997, tout l’équipage d’un navire de pêche a été brûlé, raconte Jacek Beldowski. La Marine leur a dit qu’ils avaient eu de la chance que l’incident ait eu lieu en hiver. Dans les profondeurs, le gaz gèle. Mais une fois à l’air libre, il peut se libérer. En été, le gaz aurait donc pu s’évaporer davantage et l’équipage l’aurait alors respiré. Les séquelles auraient été pires. » L’île de Bornholm, à l’est du Danemark, dans la mer Baltique, a été particulièrement touchée. Certains marins vivant là-bas ont dû subir des greffes de peau sur les mains suite à un incident malheureux. En fonction de la zone de pêche, les navires doivent donc disposer à bord de masques à gaz, de gants et de trousses médicales adaptées. Mais les brûlures ne sont pas les seuls risques pour les marins. Le 6 avril 2005, trois pêcheurs hollandais trouvaient la mort en remontant une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Elle a explosé sur leur navire.

« Beaucoup d’ombres et de non-dits »
Les accidents s’accumulent mais les actions concrètes des gouvernements sont rares. En France particulièrement, où l’accès aux archives sur le sujet est impossible : les documents sont classés secret défense. L’association Robin des Bois, qui s’intéresse aux déchets de guerre depuis sa création en 1985, dénonce une omerta. « Beaucoup d’ombres et de non-dits planent sur les armes chimiques non utilisées en France et dans les pays voisins, comme sur leur état et leurs modes de gestion », écrivait-elle dès 2008 dans une « lettre ouverte sur un secret ». Contacté lors de notre enquête, le ministère des armées nous a invité à joindre le ministère de la transition écologique et solidaire, « davantage concerné » par la question. Mais pas davantage enclin à répondre à nos sollicitations.
Les bombes immergées ne sont manifestement pas une priorité. Dominique Anelli l’a bien remarqué en octobre dernier, quand il a participé à un débat sur la chaîne Public Sénat, suite à la diffusion du documentaire Menaces en mer du nord (2018), de Jacques Lœuille. Face à lui, Christian Cambon, sénateur du Val-de-Marne et président de la Commission des Affaires Étrangères, de la Défense et des Forces Armées du Sénat. « On a vu que c’était le cadet de ses soucis. Chacun est resté sur ses positions à l’issue du débat, regrette le consultant en décontamination. Le sénateur a indiqué que ce n’était pas une dépense prioritaire pour le moment et qu’il valait mieux qu’on achète du matériel pour protéger nos hommes au Mali plutôt que de recouvrir les armes immergées. » Lui aussi contacté, Christian Cambon nous a indiqué ne pas avoir le temps pour répondre à nos questions.
Leopold Lippens ne semble pas non plus très inquiété par le sujet. Le bourgmestre de Knokke-Heist assure que la commune belge n’a jamais connu d’ennui avec ses quelque 30 000 bombes voisines. « Nous nous sentons tout à fait à l’aise, assène-t-il. Je n’ai jamais reçu de contestation de citoyens. Si ce n’est pas dangereux, qu’on les laisse comme ça et puis c’est tout. Et si cela s’avère dangereux, alors l’État doit prendre des dispositions. » Justement, la situation belge pourrait changer. Grâce à un élan écologique ? Pas tellement. On craint en premier lieu un accident qui pourrait tourner au drame, comme cela a failli être le cas en mars 1987.

À cette époque, l’Herald of Free Enterprise, un ferry qui assure une liaison transmanche, fait naufrage au large du port de Zeebruges, tout proche de l’endroit où sont immergées les munitions de Knokke-Heist. Près de 200 personnes meurent ce jour-là, mais le bilan – humain et écologique – aurait pu être bien plus lourd si le navire s’était échoué sur la zone contaminée. Jean-Pascal Zanders estime que les pressions économiques, plus qu’écologiques, pousseront les élus à agir. « Si l’on veut agrandir le port de Zeebruges ou améliorer l’exploitation touristique de la côte, il faudra aménager la zone contaminée, prévoit ce chercheur belge qui a travaillé dans différents instituts de recherches pour la paix et la sécurité à Bruxelles, Stockholm, Genève et Paris. Et même si on ne construit rien sur la zone en elle-même, les travaux à proximité peuvent perturber les mouvements de la mer et avoir un impact sur les sédiments qui recouvrent les bombes. »
S’occuper des armes immergées en mer Baltique est aussi revenu à la mode à la fin du XXe siècle, au lancement du projet Nord Stream, un gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne. Les fonds marins sur le tracé ont été sondés. Une bonne occasion pour mettre au point des solutions innovantes qui pourraient aider à résoudre le problème à l’échelle mondiale. Malheureusement, l’idée n’est pas de nettoyer toute la Baltique, les bombes gênantes étant souvent explosées directement sous l’eau. « Et le reste des munitions sur le chemin n’étant pas enlevé, juste déplacé un peu plus loin », confie Jean-Pascal Zanders. Un travail similaire a été effectué au Japon pour l’agrandissement du port de Kanda. Une centaine de munitions chimiques dans la baie voisine ont été remontées et détruites une par une sur terre. Là encore, il s’agit d’un besoin économique bien particulier. Et malgré un espace très restreint à nettoyer, l’opération se révèle fort coûteuse.

Coups d’épée dans l’eau
« Je ne vois pas ça faisable à l’échelle d’un État, coupe Dominique Anelli. Il faudrait prendre ce problème un peu comme on a pris le problème de l’environnement : des COP, des réunions avec des objectifs prioritaires, le tout accompagné d’un appui financier. » Même demande du côté de Jacek Beldowski : « Il faut créer un réseau d’experts européens qui partagent leur expérience. Actuellement, nous avons des équipes dans la Baltique, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Italie, mais personne ne travaille ensemble. En oeuvrant conjointement, on pourrait accomplir beaucoup plus avec moins d’argent. » Faute de moyens et d’informations, les ONG ne se saisissent pas vraiment non plus du dossier.
Comment réussir là où les Nations unies échouent depuis plusieurs années ? Bien sûr, il y a eu des initiatives, notamment la création de plusieurs organisations intergouvernementales. La principale est la commission d’Helsinki citée plus haut. Elle s’attache à préserver la mer Baltique de toutes les sources de pollution depuis plus de 40 ans. C’est à sa demande qu’en 2014, un rapport a été édité et constitue aujourd’hui la meilleure source d’informations sur les munitions immergées dans cette région du monde. On pourrait aussi citer la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (OSPAR), entrée en vigueur en 1998, et d’autres projets similaires, lancés depuis 1972.
Selon Terrance Long, tout cela ne sert finalement pas à grand-chose. Rien ne bouge. Le spécialiste canadien l’a remarqué au début des années 2000, quand il a interpellé le Sénat du Canada sur la question des armes chimiques. L’institution met alors en œuvre trois recommandations, mais le sujet est vite remis sous le tapis. Dépité, le spécialiste fonde donc en 2004 l’International Dialogue on Underwater Munitions (IDUM), puis participe aux nombreux projets de recherche qui ont vu le jour jusque-là. « Avec plusieurs experts, nous avons travaillé pour la commission d’Helsinki, retrace-t-il. Nous avons rendu un document qui a demandé plusieurs jours de réflexion. Une seule personne proposait de laisser les armes où elles sont. C’est la seule phrase que la commission a retenu de tout notre travail. » Terrance Long a connu la même déception en écrivant des résolutions pour les Nations unies avec l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OPWC). « Le texte que nous avions écrit ne comportait que des tournures impératives telles que ‘vous devez’, ‘il faut’. Quand il est arrivé aux gouvernements, elles avaient été remplacées par des ‘peut-être’, ‘il faudrait’, fulmine le Canadien. Nous avons écrit trente pages et le document final n’en faisait que six. Ces résolutions des Nations Unies n’étaient qu’une perte de temps. »

Selon lui, le coup de grâce vient de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques. Entrée en vigueur en 1997, elle compte 193 États parties et s’impose logiquement comme le texte de référence dans le monde. Le document présente un grand nombre de mesures concernant les armes chimiques, que les pays doivent obligatoirement respecter. Mais après toutes ces recommandations, un alinéa persuade Terrance Long que tout cela n’est « qu’une couverture politique ». L’extrait en question : « L’État partie est libre d’appliquer ou non les dispositions du présent article (…) sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985 ». Bref, en ce qui concerne les bombes jetées à l’eau avant 1985, les États font ce qu’ils veulent.
Quatre mille euros le kilo
Difficile de régler le problème quand les pêcheurs ne jouent pas forcément le jeu non plus. Au Danemark, un équipage qui remonte dans ses filets une arme chimique ou conventionnelle peut appeler la Marine et indiquer l’endroit grâce à un GPS. Les autorités envoient alors des plongeurs et détruisent l’arme sous l’eau en établissant un périmètre de sécurité. Le projet CHEMSEA a lui mis en place un protocole qui invite les pêcheurs de la mer Baltique à garder l’arme dans un coin du navire et rentrer au port avec pour qu’elle soit détruite proprement. « Mais le capitaine d’un bateau de pêche qui a une bombe dans ses filets est ennuyé, relativise Dominique Anelli. Soit il la garde à bord et suspend sa campagne de pêche le temps de la décontamination, soit il la rejette à la mer et il ne dit rien à personne. » Or le pêcheur vertueux n’est pas nécessairement indemnisé. Le choix est vite fait.
Trouver des solutions efficaces demandera de l’argent. Quand on demande à Dominique Anelli s’il a une idée du budget requis, il marque une pause. « C’est énorme… », finit-il par répondre. L’ancien expert de l’OIAC estime que la destruction des armes émergées neuves exige environ un million d’euros par tonne. Les armes émergées anciennes font grimper le compteur à deux millions la tonne. Pour les armes immergées, on peut atteindre les quatre millions. Bien sûr, il faudra aussi du temps. Selon la Radio-télévision belge francophone (RTBF), le démantèlement des obus de la zone contaminée devant Knokke-Heist demanderait 1 500 semaines de travail. Soit trente années, à raison de 2 000 munitions évacuées par semaine. « Bien sûr que ça va prendre du temps mais si on ne commence jamais, ça prendra encore plus de temps ! », s’emporte le consultant français. Il se met à rêver de campagnes sur cinquante ans avec un investissement régulier, là où les élus politiques voient rarement plus loin que les cinq années de leur mandat. « Ce ne sont pas ces histoires de décontamination qui feront gagner la prochaine élection », reconnaît-il.

Malgré deux résolutions de l’ONU et un Grenelle de la mer en 2009 qui proposaient de s’occuper de ses armes immergées, la France n’a toujours pas entrepris de campagne de récupération. Mais si l’on ne vient pas au problème, le problème viendra à nous. « Ces armes sont sous le tapis, on ne les voit pas, soupire Dominique Anelli. Il suffirait que demain, quelques tonnes soient ramenées par la mer sur les plages françaises, belges et anglaises pour que tout le monde se gratte la tête et réfléchisse à des solutions. » Justement, ce genre d’incident s’est déjà produit. Un rapport du projet CHEMSEA met d’ailleurs en garde contre cette menace potentielle, qui pourrait s’accentuer dans les années à venir. Dominique Anelli conclut par un ultime risque : « Si, demain, vous allez avec un zodiac au-dessus d’une zone de largage et que vous y plongez, vous êtes en mesure de remonter des armes. Certaines personnes pourraient le faire avec de mauvaises intentions. »
Le documentaire Menaces en mers du nord (2018) a légèrement fait bouger les choses. Plusieurs médias ont évoqué le problème et certains députés s’y sont intéressés. C’est le cas de Christian Hutin, élu du Nord. Lui qui se dit « sidéré » par le film, reconnaît qu’il n’ignorait pas le problème mais ne « pensai[t] pas que le risque était aussi grand. » En février dernier, il a donc envoyé un courrier sur le sujet au Premier ministre, suivi par quelques députés des zones littorales. Aucun n’a reçu de réponse du gouvernement. « On va laisser passer les municipales et on verra ce qu’on fait ensuite », assure Christian Hutin. Et voilà cette histoire de bombes immergées vite remise sous le tapis.
Robin Richardot